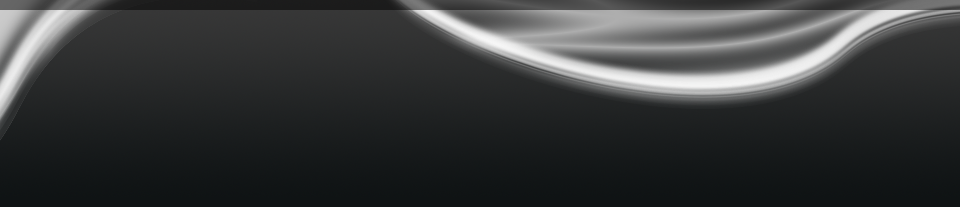La statue en bronze ( XIXe siècle) de saint Martin domine la ville de Tours . Le bras avec lequel il esquisse un geste de bénédiction de la Cité contenait des reliques de Martin ainsi que de trois autres évêques tourangeaux : Brice son premier successeur qui élève un oratoire, Perpet qui construisit la première basilique, Grégoire de Tours (539-594) qui en fait sa description.
Le nombre de localités et de sanctuaires qui portent le nom de Martin est considérable. Il en est ainsi de lieux « martiniens » connus à l'instar de la cathédrale Saint-Martin de Mayence qui fut historiquement la plus importante cathédrale de tout le royaume médiéval de Germanie ou de ces centaines d'églises, modestes ou grandes, dédiées à Saint-Martin à travers toute l’Europe.
A quoi tient une telle célébrité ?
Martin de Tours en quelques dates

Collégiale Saint-Martin de Candes, Indre-et-Loire.
Saints et apôtres de la partie droite de la galerie supérieure de la façade ( XIIIe siècle ).

Collégiale Saint-Martin de Candes, Indre-et-Loire.
Détail de la galerie droite de la façade : saint Martin.
Qui est saint Martin ? La réponse est sans doute différente pour chacun mais dans la mémoire collective c'est l’homme du « manteau partagé ».
Quelques dates repères sont tout de même utiles pour saisir la succession d'images qui lui ont été consacrées.
Ce nom de Martin semble tellement connu, trop connu sans doute. Ce n’est pas un personnage légendaire mais un homme ayant réellement vécu au IVe siècle de notre ère.
Sulpice Sévère, admirateur de Martin, décida de raconter sa vie, ou plutôt de faire l’éloge de sa sainteté. Ce qu’on appelle la vie de saint Martin, le texte fondamental qui nous permet de connaître Martin, n’est pas exactement une biographie mais, sous l’apparence d’un récit vif, concret et enthousiaste, c’est la démonstration des vertus d’un homme habité par le Christ.
Dès le Ve siècle, le culte martinien donne lieu à un cycle hagiographique, c'est-à-dire à une série d'images successives relatant les faits et gestes du saint.

Parmi les hauts vitraux du chœur ( XIIIe siècle ) de la cathédrale Saint-Gatien de Tours, Indre-et-Loire, proche du vitrail axial consacré à la Passion du Christ, la verrière propose un parcours en trois lancettes des épisodes les plus célèbres de la vie de saint Martin.
* Les premières années
- 316 : naissance dans une famille païenne en Pannonie ( Hongrie ).
- 321: jeunesse à Pavie en Italie.
- Il entre dans l'armée en 332 où il servira dans la cavalerie impériale. Il traite son esclave en égal…

Détail d'une verrière du chœur de la cathédrale Saint-Gatien, Tours.
Sur ce panneau l'empereur remet à Martin les armes de soldat romain.
* 334 est l'année du fameux partage du manteau à Amiens
Il est connu par la légende biblique de la « charité de Saint-Martin », durant laquelle ce soldat dans les légions romaines, aurait partagé son manteau pour couvrir un nécessiteux transi de froid.
Alors qu’il était en garnison à Amiens, en Gaule, un jour d’hiver glacial, un mendiant nu implora son secours. Martin, n’ayant plus d’argent sur lui, coupa son manteau en deux et en donna une moitié au mendiant.
La nuit suivante, Martin vit en songe le Christ revêtu de la moitié de manteau donné au pauvre.
C’est le début de sa légende.
Martin eut très tôt la volonté de devenir chrétien et de vivre une vie totalement consacrée à Dieu. Martin baptisé en 354 quittera l’armé en 356.

Détail d'une verrière du chœur de la cathédrale Saint-Gatien, Tours.
Martin est baptisé par un évêque.
* A l'automne 356 Martin devient disciple d’Hilaire l'évêque de Poitiers.
En 357 il retourne en Pannonie pour amener à ses parents la bonne nouvelle du salut. Seule sa mère se convertit.
Détail d'une verrière du chœur de la cathédrale Saint-Gatien, Tours.
Parti pour convertir ses parents, il est assailli par des voleurs.
Il évangélise l’Illyrie en combattant l’hérésie arienne.
* Saint Martin fonde le monastère de Ligugé en 361
Pour vivre sa foi avec une plus grande intensité, il choisit de devenir ermite, d’abord à Milan puis sur l’île de Gallinara.
Martin retrouve Hilaire à Poitiers.Tous deux partagent la même foi orthodoxe du concile de Nicée. Il est ordonné diacre, puis prêtre.
Depuis le règne de l’empereur Constantin (306-337), les chrétiens peuvent pratiquer librement leur culte, mais seule une trentaine d’évêchés existent en Gaule où les religions traditionnelles païennes continuent d’être largement célébrées. En outre, dans tout l’Empire, les évêques se déchirent sur les thèses d’un certain Arius qui refuse de reconnaître que le Fils est de même nature divine que le Père.

© Abbaye de Ligugé
Cerf broutant, partie d'ambon, XIe siècle.
Il se retire à Ligugé où il construisit une cabane sur un site cultuel gallo-romain partiellement ruiné. Autour de lui, de nombreux disciples se rassemblèrent, logeant dans de petites huttes et dans des grottes. Ligugé deviendra en peu d’années le premier monastère d’Occident.
Martin, thaumaturge, accomplit des miracles, il ressuscite notamment un jeune frère catéchumène.
* Evêque de Tours de 371 à 397
A la mort de Saint Hilaire, en 367, Martin refuse de succéder comme évêque de Poitiers à celui qui fut son maître.
Quelques années plus tard la population de Tours, instruite des pouvoirs du thaumaturge, l’élit évêque contre son gré. En recevant l'ordination épiscopale le 4 juillet 371 il deviendra le troisième évêque de Tours après saint Lidoire.

La basilique Saint-Martin telle qu'elle se présentait aux XIe-XIIIe siècles.
Seules subsistent aujourd'hui isolées la tour Charlemagne ( au premier plan à gauche ) et la tour de l'Horloge ( au second plan à droite, du côté sud de la façade ).
Martin couronné par Dieu, détail d'une fresque du XIe siècle dans la tour Charlemagne (on devine une main tenant une couronne sur sa tête)
[Lelong 1986, photo Collon-Arsicaud). 
Les ouvertures sur les côtés du sarcophage permettent de découvrir les pierres du reliquaire de saint Martin qui avait été inhumé le 11 novembre 397 " dans le cimetière du bourg des chrétiens " aux abords de l'actuelle rue des Halles.

Ce fragment de calcaire est probablement un témoignage du tombeau de saint Martin du Ve siècle.
Gravée dans un cadre l'inscription " FESTUS OM entrerait dans l'inscription de l'épigramme qui était gravée sur un côté du tombeau du saint.
* En 372 fondation du monastère de Marmoutier
Martin prend à cœur sa nouvelle fonction épiscopale mais veut aussi rester moine et fonde, à proximité de Tours, un ermitage. Un grand nombre de frères l’y rejoignent et l’ermitage deviendra un monastère.

Crédit photo : Akarikurosaki
Vestiges de l'ancienne abbaye de Marmoutier : grottes réaménagées à la fin du XIXe siècle et tour des cloches, clocher, séparé de l’église romane, édifié au XIe siècle.
* Activité missionnaire et voyages apostoliques des années durant.
Martin ne limite pas son action pastorale au seul diocèse de Tours.
Il est profondément engagé contre l’arianisme. Il évangélise les campagnes, détruisant les temples païens et construisant des églises à leurs place.
Il voyage à travers la Gaule et l'Europe, lutte contre le paganisme par des actes spectaculaires mais surtout par des gestes de miséricorde : chasse les démons, guérisons miraculeuses jalonnent ses déplacements.
Il a gagné les paysans au christianisme.
Par ailleurs Martin participa en 38O au synode des évêques à Vienne et prit part en 384 au concile de Bordeaux.
Il n’hésite pas à rencontrer les empereurs pour plaider la cause des condamnés. Il rencontre ainsi à Trèves l’empereur Valentinien vers 372-373, plus tard l’empereur Maxime, en particulier à propos de Priscillien, donc vers 384-385.
* Mort de Martin à Candes, le 8 novembre 397, paroisse qu’il avait fondée à la confluence de la Loire et de la Vienne et où il était venu régler un différend entre des religieux de son diocèse.

Candes-Saint-Martin dans son site, au confluent de la Vienne et de la Loire.
Poitevins et Tourangeaux se seraient disputé sa dépouille ! Signe que pour une partie de la population au moins, il est déjà considéré comme saint. Jusque-là le saint était un martyr, mort de mort violente, or Martin était mort de vieillesse.
Bien sûr faut-il faut comprendre que Sulpice Sévère a délibérément voulu présenter Martin en tant que saint et que cette qualification n’allait pas de soi à la fin du IVe siècle. Martin ne fait pas l’unanimité. Il a des disciples fervents mais aussi de nombreux critiques. Son successeur à l'épiscopat, Brice, a tenté de freiner la popularité posthume de Martin ; en revanche, Perpetuus, en 460, fait construire une grande basilique sur son tombeau.
La légende s’empare dès lors de sa mémoire. La popularité de cet homme est telle qu’en France, 220 villes et villages portent son nom et que des milliers de monuments lui sont dédiés.
Nombreux également sont les légendes et traditions qui font écho à ce personnage sur des sujets aussi variés que l’alimentation, la viticulture, la météorologie (… ne parle-t-on pas de l'été de la saint Martin pour évoquer un bel automne).
Les pèlerins se réuniront de plus en plus nombreux sur son tombeau. Tours devenant ainsi historiquement une ville de pèlerinage.
**********
Notre évocation imagée portera d'abord sur la scène du manteau partagé puisque c'est le geste le plus connu de la popularité de Martin à travers les siècles ; elle portera, ensuite, sur les représentations de Martin habité par le Christ ; évangélisateur à travers l'Europe, il a répandu la foi.
Les sculptures, fresques et vitraux montreront comment les artistes des XI-XII-XIIIe siècles ont représenté la vie de l'apôtre des Gaules que certains ont pu baptiser
de " treizième apôtre ".
_____________________________