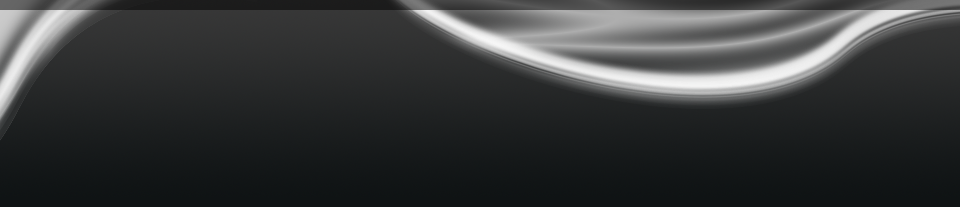Les bâtiments d'accueil des hôtes et des pèlerins
________

Bâtiments du XIVe siècle face Nord disposés en équerre : aile de l'hostellerie avec son pignon triangulaire vestige d'une toiture d'ardoise disparue ( à gauche ) et ce qui a été longtemps appelée l'aile des convers ( à droite ). De nos jours les historiens pensent plutôt que l'on serait en présence d'un espace destiné aux voyageurs et pèlerins.

Réfectoire et dortoir des hôtes de marque à gauche dans le bâtiment à pignon triangulaire ; cuisine et réfectoire des pèlerins à droite.
.jpg)
Les petites fenêtres rectangulaires à l'étage supérieur indiquent le dortoir des pèlerins au-dessus du réfectoire.

Un dépôt lapidaire a été réalisé au réfectoire des pèlerins avec des éléments sculptés récupérés ( modillons, chapiteau, décors ) sur le site de l'abbaye au hasard des travaux.
Leur étonnante qualité de conservation s'explique par le fait qu'ils étaient disposés la plupart du temps " à l'envers ".

Claveau double du XIIe siècle. Un centaure à visage humain est étiré pour se fondre sur la moulure. A droite, un chien replié sur lui-même se mord la patte arrière. ( Dépôt lapidaire )
Claveaux du milieu du XIIe siècle : masques avalant une palmette ajourée ( Dépôt lapidaire ).
Des baies géminées en arc brisé donnant sur le marais éclairent la pièce. On peut remarquer les coursières ( banquettes ).
Sur le côté Sud de cette grande salle rectangulaire on trouve les arrachements d'une cheminée monumentale d'un réfectoire longtemps attribué à la communauté des frères convers.
Cuisine dite des hôtes avec les restes d'une hotte-cheminée monumentale octogonale en pierre de taille qui a perdu la pyramide qui lui servait de cheminée ; ces vestiges rappellent les fameuses cuisines de l'abbaye de Fontevraud.

Des similitudes apparaissent avec les grandes cuisines de l'abbaye de Fontevraud, Maine-et-Loire ( En 2019 elles sont en cours de restauration ).
A côté d'un petit placard aménagé dans l'épaisseur du mur on observe l'arc brisé d'un grand passe-plats aujourd'hui muré.
Salle de prestige communément appelée le réfectoire des hôtes de " haut rang ".
Cette salle des XIIIe et XIV e siècles s'étendait au-delà du mur Sud sur toute la longueur du bâtiment 
A l'extérieur de cette pièce se remarquent les traces d'un voûtement.
La " cave à sel " voûtée en berceau brisé avec ses nombreux arcs doubleaux.

La maçonnerie s'appuie de façon visible sur les enrochements.  Partie de ce long sous-sol voûté qu'est ce cellier du XIIe siècle.
Partie de ce long sous-sol voûté qu'est ce cellier du XIIe siècle.

Au fond, à gauche, l'ancien accès direct sur le marais de ce lieu de stockage.
Dès votre entrée sur le site monastique, tels les pèlerins et voyageurs de l'époque, vous découvrez r la façade monumentale Sud des bâtiments de l'hôtellerie.
entre la tour-porte à gauche et l'échauguette à droite.
Le bâtiment à pignon comporte plusieurs niveaux singuliers :
- au niveau inférieur le " cachot de Rabelais ",
- au niveau médian le réfectoire des hôtes,
- au registre supérieur le dortoir des hôtes.

Partie centrale du bâtiment : sous le dortoir des pèlerins les fenêtres en ogive à gauche ouvrent sur le réfectoire des voyageurs que jouxte la cuisine à la troisième baie du même type.

Au registre inférieur du bâtiment se trouve la fameuse " cave à sel " : les petites baies et la porte donnent sur cette belle salle voûtée..jpg) Vestiges de la tour-porte de défense romane datant de 1028. On pense qu'à cet emplacement a pu se dresser au Xe siècle une forteresse pour se protéger de l'invasion des Normands.
Vestiges de la tour-porte de défense romane datant de 1028. On pense qu'à cet emplacement a pu se dresser au Xe siècle une forteresse pour se protéger de l'invasion des Normands.
__________________________________________