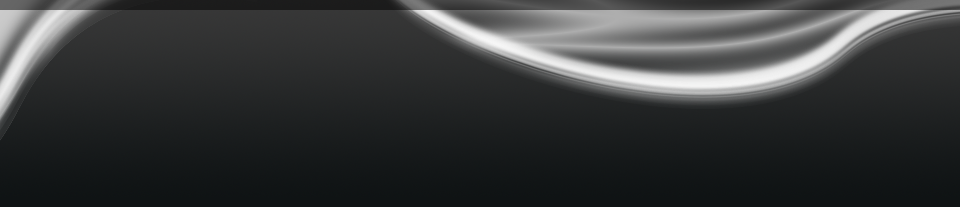Croix et crucifixions,
reflets de l'évolution de la spiritualité
au fil des siècles
___________
L a croix est un supplice ignominieux mais c'est aussi dans la tradition chrétienne le symbole du salut. La difficulté qu'éprouvent les enlumineurs, peintres et sculpteurs dans leurs représentations de la crucifixion réside dans le mode de figuration de la double nature du Christ, Dieu et homme.
L’image de la Crucifixion n’est pas dans l’Eglise primitive régie par les mêmes canons qu’aux siècles suivants. Les chrétiens ont exclu la crucifixion de leurs représentations pendant quatre siècles…la crucifixion était un supplice infamant et provoquant une agonie atroce. Elle était réservée aux esclaves et aux traîtres. Il était donc tout simplement impossible aux premiers chrétiens d’affronter cette image. Le traumatisme était trop fort.
Dans le premier art chrétien les images ne montrent pas le supplicié. La Résurrection et le retour glorieux sont privilégiés ; l’important pour les premières communautés était la victoire que le Christ avait remportée sur la mort, l’attente de son retour et l’espérance du salut. Symboles et allégories de la croix glorieuse sont utilisés : ancre, poisson, agneau, bon pasteur, chrisme….
✏︎ La croix comme signe de victoire apparaît ainsi assez tôt sur des sarcophages chrétiens mais elle est dépourvue de toute figuration du Christ crucifié, ; elle est parfois accompagnée d'un chrisme comme on peut le voir sur certains monuments romains et sur certaines dalles en Poitou.
_________________________
Crédit photo : Jastrow, Wikipedia.org
Anastasis, représentation symbolique de la Résurrection du Christ.
Panneau d'un sarcophage romain sans couvercle du type de la Passion. Rome.Vers 350.
Une croix surmontée du monogramme du Christ inscrit dans un médaillon ( signe formé par les deux premières lettres du nom du Christ en grec : X et P ). Deux colombes et deux soldats encadrent l'instrument du supplice. Un garde romain du tombeau de Jésus dort au pied de la croix tandis que l'autre, éveillé, regarde la croix.
.jpg)
Eglise Saint-Gervais et Saint-Protais, Civaux, Vienne. V-VIIe et XI-XIIe s.
Dans le mur de l'abside on peut observer une dalle gravée, à l'origine fixée à l'extérieur, et remontée à l'intérieur de l'abside.
Sous le chrisme entouré de l'alpha et de l'omega, IV- Ve s. l'inscription : Aeternalis et Servilla, vivatis in Deo », « Eternel et Petite Servante, vivez en Dieu ».
✏︎ C'est progressivement que la croix va s'imposer comme symbole chrétien. Il a fallu d'abord comprendre comment la croix de signe d'infamie devienne un signe de victoire, puis un signe sauveur.
Jusqu’au Ve siècle, ce motif restera ainsi absent dans l’art chrétien. Il ne deviendra possible de représenter la crucifixion que lorsque l'horreur de ce supplice, réservé aux esclaves fugitifs et aux voleurs, cessera d'être un souvenir douloureux pour les communautés chrétiennes. Pour qu'un art de la croix puisse se développer sans véhiculer de connotations négatives il faut attendre, après la conversion de Constantin, que le christianisme devienne la religion officielle de l’Empire et que Théodose mette fin au supplice de la crucifixion.
** Relief en bois des trois croix du Calvaire, vers 430-440.

Crédit photo : Peter 1936F, Wikipedia
Un des 28 panneaux de la porte de la basilique Sainte-Sabine, Rome.
La Crucifixion est représentée par un groupe de trois personnes debout dont les pieds reposant sur le sol ne sont pas cloués. Au centre, le Christ barbu et les cheveux longs, est de taille supérieure à celle des deux larrons, jeunes gens imberbes qui l'encadrent. Le Crucifié, vêtu du subligaculum, est figuré la tête droite et les yeux ouverts, mais sans nimbe. La croix n'est suggérée que par des planchettes sur lesquelles sont fixées les mains évoquant la traverse de l'instrument du supplice. La scène se déroule sans témoins devant les murailles de Jérusalem.
** Une enluminure du VIe siècle est une des premières représentations connues de la crucifixion. On a pu dire que la crucifixion du manuscrit des Evangiles de Rabula serait la première à offrir un développement complet du thème de la crucifixion.

Evangéliaire de Rabbula VIe siècle. Biblioteca Medicea Laurenziana, Florence. Wikipedia :0/0d/Meister
Le Crucifié est élevé bien haut sur une croix qui domine celles des larrons. De frêle constitution ,en comparaison de ses compagnons d'infortune, il incline doucement la tête vers l'épaule droite, son visage étant cerné d'un nimbe immense. Son corps s'étale largement sur l'instrument du supplice auquel ses pieds et ses mains sont fixés par quatre clous. Ses mains sont fléchies et ses jambes légèrement déviées vers la droite de l'image.
Un somptueux colobium ( longue tunique sans manche ) violet bordé par deux larges bandes d'or le recouvre presque entièrement. Les pans de la longue tunique s'écartent au côté droit et laissent apparaître le flanc percé par un porte-lance vigoureux qu'une inscription au-dessus de sa tête désigne comme Longin ; des filets de sang coulent des plaies ; de l'autre côté est figuré le porte-éponge avec son instrument et son seau.
Le Crucifié porte un regard triste et mélancolique sur le disciple et sur la Vierge qu'auréole un large limbe. A ses côtés se dressent les larrons simplement vêtus du perizonium ( sorte de pagne court descendant au-dessus des genoux et comportant un nœud serré à la ceinture ) le buste ligoté à la croix les mains et les pieds transpercés par les clous ; le larron à gauche jeune et imberbe penche la tête vers le Christ; le larron de droite, au contraire, se redresse et paraît dévisager Jésus avec arrogance; non loin de lui se pressent trois femmes.
Le soleil et la lune sont présents mais intervertis ; au pied de la croix trois soldats tirent au sort la tunique du Christ.
( Cette représentation est complétée par une scène inférieure évoquant le mystère de la Résurrection en train de s'accomplir ; ainsi l'ensemble de la composition révèle que Jésus appartient à deux ordres à la fois, l'humain et le divin. La Résurrection du Christ est la condition pour que la croix fasse véritablement sens ).
** Un panneau de tête d'une cuve de sarcophage, de la fin du VI e-milieu du VII e siècle offre une représentation d'un tout autre ordre mais non dépourvue d'originalité.

Extérieur du mur Nord de l'église Saint-Martin, Pouillé, Vienne.
Ici la crucifixion serait évoquée par l'ensemble de deux croix encadrant de façon symétrique un arbre central autour duquel s'enroule un serpent saisissant un fruit rond.
Anne Flammin voit dans cette représentation, non seulement le thème de la croix-arbre de vie mais " le serpent d'airain, préfigure de la Rédemption…( en tant que ) figure du Fils de Dieu sauvant le monde sur le bois de la croix. Il renvoie à la tentation d'Adam et la symbolise, Adam ayant été définitivement racheté par le sacrifice du Christ sur la Croix "; ( in R.Favreau, 2000, p. 46 )
✏︎ Une nouvelle étape iconographique sera franchie lorsque la figuration du Christ crucifié dans son corps apparaîtra - rendant ainsi témoignage de son Incarnation et de sa Passion- ; il sera représenté vivant, avec une tonalité encore glorieuse, notamment avec les yeux grands ouverts. L’ image met encore en avant davantage le message de la victoire du Christ sur la mort que la souffrance provoquée par le supplice.
** Les débuts de la crucifixion triomphale.
Ce n’est qu’au VIIIe siècle que de grandes Crucifixions commencent à apparaître dans des églises ( grande peinture murale de Santa Antiqua à Rome par exemple vers 741-752 ) et dans l'enluminure comme dans le Sacramentaire de Gellone vers 790.

Christ en croix entre deux anges
Diocèse de Meaux ou Cambrai (?), fin du VIIIe siècle.
BnF, Manuscrits, Latin 12048 fol. 143v ©Bibliothèque nationale de France
Crédit photo : onditmedievalpasmoyenageux.fr/les-temps-merovingiens/
Le corps dénué de vigueur du Crucifié seul ( non flanqué des deux larrons ) vêtu d'un grand perizonium noué sur le ventre qui lui recouvre les cuisses ; le visage est entouré par un nimbe jaune d'or frappé d'une croix rouge vif ; le regard est droit et tourné vers le ciel. Les mains sont à l'horizontale.
Deux créatures célestes couleur d'or, semblant désigner de leurs mains tendues le Crucifié à notre attention, glorifient, le Seigneur incarné.
Dans la lignée du Codex Rabbula ce Crucifié semble au-delà de l'opposition entre la mort et la vie.
✏︎ Aux X-XIIe siècles la représentation du Christ en croix a été traduite sur tous les supports.
** Dans le Poitou, par exemple, on trouve une Crucifixion sur un missel à l'usage de la collégiale Sainte-Radegonde ( deuxième quart du XIIe siècle).

Médiathèque François Mitterrand, ms 40 ( 132 ), Poitiers, Vienne.
Le Christ est crucifié sur un bois de supplice quelque peu singulier caractérisé par les bras de la traverse marqués par un certain évasement et par leur aspect végétal donné par la couleur verte pouvant évoquer la croix-arbre de vie. Les jambes sont fléchies et les deux pieds cloués sont légèrement écartés.
A côté de la croix, Marie, auréolée, a la tête inclinée avec un voile retombant sur l'épaule ; ses mains sont ouvertes en position d'orante.
Saint Jean, pieds nus tient le Livre d'une main et sa joue de l'autre.
Deux médaillons, de part et d'autre de la croix, représentations du Soleil et de la Lune, semblent essuyer leurs larmes de leur voile.
**À l'âge roman, période de notre parcours imagé, Crucifixion et Résurrection sont liées. Conformément aux Évangiles, la Crucifixion n’est pas la fin; la Croix est un passage. Donc le Christ cloué en croix apparaît vivant, le corps dépourvu des marques de la douleur extrême ; le Sauveur glorieux et paisible est figuré comme ayant triomphé de la mort.
On parle de crucifixions triomphales tant dans les sculptures, fresques, crucifix et vitraux.
** En revanche, pendant la seconde période du gothique, à partir du XIIIe siècle la passion du spectacle de la souffrance va l’emporter ; le réalisme volontiers macabre du XVe figurera ainsi volontiers un supplicié sanglant.
Pour qui voudrait aller au-delà et comprendre la spectaculaire évolution du motif de la crucifixion il convient de se se reporter au grand livre de référence sur le sujet qu'est " La Crucifixion dans l’art - un sujet planétaire "de François Bœspflug et Emanuela Fogliadini, Bayard 2019.
Pour notre part, dans ce site seront proposées au regard du visiteur des images romanes de crucifixions et descentes de croix en Poitou et de foyers régionaux d'autres régions françaises ainsi, à titre de comparaison, des compositions scéniques d'au-delà des Pyrénées.
__________________