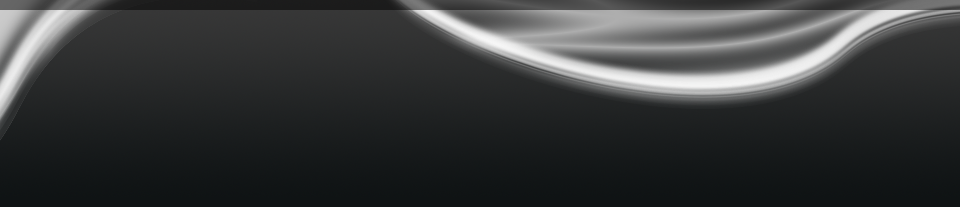Vous avez dit Pas-de-Saint-Jacques ?
Ce nom évoque aujourd’hui pour nombre d’habitants de Buxerolles avant tout un quartier, une zone d'activités, une grande surface commerciale et peut-être surtout les salles obscures d’un complexe cinématographique...
Mais c’est aussi, à deux pas du site économique, un lieu aujourd’hui fort discret qui fut pourtant très fréquenté toute l’année jusqu’au début du XIXe siècle : la Croix de Saint-Jacques.
En outre, non loin de ce site des fouilles archéologiques, réalisées lors de la création de nouveaux lotissements, ont révélé des vestiges de plusieurs époques.
✏︎Le Pas-de-Saint-Jacques : un site légendaire singulier

( Chœur de l'église du bourg ).
Statue du XVIIe siècle de Saint Jacques le Majeur en tenue de jacquet ; il a perdu son bourdon mais dispose des fameuses coquilles saint-Jacques sur sa pèlerine.
On sait que les routes qui mènent à Saint-Jacques de Compostelle en Galice correspondent classiquement à quatre principaux itinéraires.
On parle aujourd'hui de chemin de Vézelay, de la route du Puy-en-Velay, de la via Tolosana, qui passe par Toulouse ( aussi communément appelée chemin d'Arles), et de la via Turonensis qui passe par Paris et Tours.
Les pèlerins empruntant traditionnellement la Voie Turonensis passaient par Paris, gagnaient Orléans, puis Tours pour se recueillir sur la tombe de Saint Martin. Par Sainte Catherine de Fierbois et Châtellerault ils arrivaient à Poitiers où ils allaient prier devant les reliques de Saint Hilaire, l’évêque fondateur du diocèse. Ils pouvaient aussi se recueillir devant sainte Radegonde en son église et vénérer Marie à Notre-Dame-la-Grande. Après, ils continuaient sur Melle, Saint-Jean d'Angély, Saint-Eutrope de Saintes et la ville de Bordeaux.
La route principale du grand chemin de Saint-Jacques se trouve flanquée non seulement d'itinéraires secondaires mais aussi de chemins légendaires, qu’aurait emprunté l’apôtre venu évangéliser le monde occidental, et qu’on retrouve ici ou là.
Il en est ainsi du « Pas de Saint-Jacques » au vieux bourg de Buxerolles qui voyait passer les pèlerins suivant le « chemin de Tours » lequel empruntait les voies romaines.
Ce site est mentionné dès le Moyen Age comme un but d’étape sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. « Iste Pergravit Roman Jacobumque Pictavis » ( il alla en pèlerinage à Rome et Saint-Jacques du Poitou ) peut-on lire dans l'épitaphe en vers latins de Pierre Soubrebost, chanoine de Limoges, mort en 1384 ; c'est ce que rapporte Monseigneur Xavier Barbier de Montault dans son étude sur les environs de Poitiers publiée en 1872.

A l’époque médiévale, certains groupes de pèlerins se rendant à Saint-Jacques de Compostelle, en empruntant la voie Turonensis pouvaient faire étape au pays des Buis et prier devant le calvaire du Pas-de-Saint-Jacques.

Pas de Saint-Jacques, église du Bourg, voies romaines. A partir d'un schéma dressé par l'école du Planty et paru dans le livre " Buxerolles le pays des Buis" de J. Thimonier.

Arrivés à ce calvaire les pèlerins pouvaient se recueillir sur de singulières empreintes, encore visibles actuellement.
Cette croix fut très fréquentée toute l'année jusqu'au début du XIXe siècle ; une période de ralentissement s’ensuivit ; de nos jours un jacquet avec coquille et bourdon peut de temps en temps être vu de nouveau en ce lieu.
La croix est fixée dans un socle carré à deux niveaux, en moellons. Avant la belle croix en bois qui s’offre au regard aujourd’hui, il y eut bien d’autres croix. Ainsi, le 31 juillet 1870, la « très vieille croix » a été remplacée par une croix en chêne « mesurant trois mètres de hauteur » et « portée en procession depuis la cour du presbytère jusqu’au lieu d’érection ».
 Tombée en 1955, la croix avait été remontée en béton, et l'ancienne statue du Christ, alors brisée, avait été ressoudée et remontée. Nouvelle croix en chêne actuelle.
Tombée en 1955, la croix avait été remontée en béton, et l'ancienne statue du Christ, alors brisée, avait été ressoudée et remontée. Nouvelle croix en chêne actuelle.

Au pied de ce calvaire, côté Nord, se trouve un gros bloc calcaire aux formes naturelles fort singulières que les pèlerins allant en Galice n’hésiteront pas à transformer en objet de culte.
Il s'agit d'un rocher présentant deux marques encore visibles aujourd’hui : l'une des cavités qu'on y observe serait, selon une très ancienne tradition populaire, l'empreinte du pied de saint Jacques, tandis qu'une autre aurait été formée par l'extrémité de son bâton de marche.
A l’époque médiévale l'eau de pluie recueillie dans ces cavités était considérée comme miraculeuse.

Les pèlerins rejoignaient ensuite l’église du bourg toute proche : l’église dédiée à Saint-Jacques et à Saint-Philippe
où ils pouvaient, selon la tradition, se reposer dans le cimetière jouxtant autrefois l'église.
La place aujourd'hui située devant l'église du bourg, à l'Ouest, occupe l'emplacement de l'ancien cimetière qui se situait là jusqu'en 1873.
Là, le seigneur de Buxerolles leur fournissait des subsistances, et notamment des fouaces, les gâteaux populaires du Poitou.
✏︎ A la Grande Sablière, de premières occupations humaines
En ce lieu-dit quelques témoignages de présence humaine ancienne intermittente ont été mis au jour lors de fouilles archéologiques préventives à la construction de deux lotissements.
En 2013, une équipe de l’Inrap sous la direction de Marie-Luce Merleau responsable scientifique de l’opération, est intervenue sur le site.
Les recherches menées par les archéologues ont révélé deux phases d'occupation correspondant chacune à un habitat associé à des sépultures, mêlant ainsi les vivants et les morts.
1° Si quelques silex taillés révèlent une présence humaine au paléolithique ( découverte de silex taillés ) c'est au néolithique, du Ve millénaire au premier tiers du IIIe millénaire avant notre ère, que l'homme en voie de sédentarisation a marqué le site de son empreinte.
Les chercheurs ont mis au jour plusieurs structures comme une tranchée continue de 76 m de long, probablement la fondation d'une palissade simple qui délimitait l'éperon rocheux. Sa datation au carbone 14 la situe vers 4770 à 4550 avant notre ère.
A l'intérieur de l'enceinte, six fosses correspondent à des foyers à pierres chauffées, leurs longueurs vont de 2,6 m à 15,25 m.

Plusieurs sépultures témoignent des pratiques funéraires, avec des corps dont la tête est à l'est et regarde le sud. Une autre tombe présente deux corps qui se font face.

Photo M.L. Marleau, Inrap.
Une tombe d'adulte déposé sur le côté droit.
Enfin, la tombe aux caprinés interroge: un corps de femme accompagné de celui d'une chèvre déposé sur ses jambes.

2° Après un long abandon le site reçoit aux Xe et XIe siècles, une ferme.
Un bâtiment quadrangulaire construit sur des poteaux abritait une sole et des fosses livrent quelques éléments de vaisselle: grandes jattes, pots à cuire, pichets...
A proximité du bâtiment, une quinzaine de silos cylindriques témoignent des activités agricoles.
A une quarantaine de mètres, une dizaine de tombes d'enfants de 2 à 6 ans entourent celle d'une femme.

© Région Poitou-Charentes - Communauté d’agglomération de Poitiers / Y. Suire, 2007.
Fosses et trous de poteaux du bâtiment naviforme.
** On peut aussi rappeler qu'au lieu-dit "Terre qui Fume" dans l'actuel secteur du Pas-de-Saint-Jacques
En 2004, des fouilles archéologiques ont révélé des traces de civilisation datant du néolithique et de l'âge du Bronze. Des inhumations associées au Néolithique avaient notamment étaient retrouvées.

Vue générale de trois des sépultures retrouvées.
Maguer P. Dir., Buxerolles, Terre qui Fume : rapport final d'opérations Inrap préventives, octobre 2004, p. 11.
Direction régionale des affaires culturelles de Poitou-Charentes, Service régional de l'archéologie, Poitiers
Yannis (reproduction) Suire
_______________
* Site archéologique du Pas-de-Saint-Jacques et de la Terre qui Fume
https://gertrude-diffusion.poitou-charentes.fr/illustration/ivr5420078601495nuc/8ea01d26-e357-48ef-9460-5f9a012c5fb8
* Josette Asserin - Les fouilles de la Grande Sablière en 2013, Gazette des Buis n°12.
* Joseph Thimonier - Buxerolles, le pays des Buis, Les éditions du Pont-Neuf, 1998.