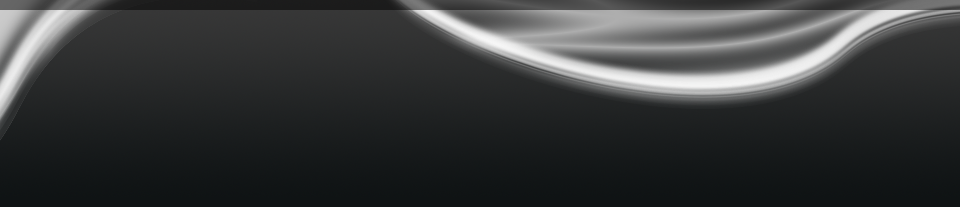La "mare de la grande Fosse" à l'Ormeau, devant laquelle le lutrin a été installé. Elle figure au cadastre de 1817 et servait d’abreuvoir aux bestiaux des métairies voisines.
Le hameau de l'Ormeau, ou "l'Humeau" sous l'Ancien Régime, hameau apparaît au début du XIXe siècle, sur le cadastre de 1817, comme constitué de plusieurs métairies.
Le hameau de l'Orbras, autrefois aussi appelé "Rebras", a en grande partie lui aussi conservé sa physionomie du début du XIXe siècle, telle qu'elle apparaît sur le cadastre de 1817. On y voit ce qui constituait probablement les métairies citées aux XVII et XVIIIe siècles. Plusieurs de ces bâtiments ont toutefois été reconstruits au cours du XIXe siècle.
✏︎ Le manoir de la Loubantière
Le manoir est une ancienne grosse demeure attachée à un fief seigneurial : la Loubantière. Sous l'Ancien Régime, la Loubantière est l'un des fiefs les plus importants et les plus possessionnés de Buxerolles. Il est mentionné vers 1112 sous le nom de "Lobanterias", en 1221 sous celui de "Lobantère" et en 1404 sous celui de "Loubantère"( pays des loups ).
Le logis aurait été reconstruit en 1762.

L'accès principal du manoir se trouve au Sud sur la rue de l'Ormeau..jpg)
Plan sur les initiales B et J entrelacées du couronnement du portail.
L'allée bordée d'arbres débouche sur une seconde clôture en fer forgé en avant de la demeure.
Les piliers de pierre de taille de la deuxième clôture sont décorés de fines moulurations et chapeaux variés : sphère, polyèdre…

L'ancien domaine seigneurial est également accessible par l'Est, par le chemin de la Loubantière.
Là se trouve un autre portail avec chasse-roues et dont les piliers maçonnés supportent à nouveau des acrotères avec amortissement en forme d'étoile.
A gauche de ce portail, on observe une porte à arc en plein cintre.

Gros plan sur l'élégante façade de la demeure qui dispose d'un toit à longs pans brisés comportant de belles lucarnes avec fronton en arc segmentaire sur une toiture à la Mansart.

Les lucarnes en chapeau de gendarme sont une variante du linteau curviligne. Les extrémités du linteau qui prennent appui sur le jambage sont droites alors que la partie centrale est incurvée. Cette double courbure très allongée, évoque le bicorne, modèle de couvre-chef masculin à deux " cornes " d'une époque. Une moulure encadre la baie.
.jpg)
Une vue rapprochée du chapeau de gendarme révèle la date de construction : 1762.

Un acte en date du 28 janvier 1512 précise que le domaine comprend déjà une garenne et un pigeonnier dont on ne peut apercevoir que le toit conique depuis l'espace public.
Seule une aérienne du domaine de la Loubantière à l'aide de Google Earth permet de se rendre compte de l'éloignement du pigeonnier du corps de logis résidentiel afin d'éviter les dégradations causées par les pigeons sur la toiture de ce dernier.

Vue plongeant sur le pigeonnier du domaine. ( Google Earth ).
Cet ancien édifice, aux 1000 boulins dit-on, se classe parmi les pigeonniers isolés circulaires de type sur pied séparé. A l'origine possédait-il des murs lisses munis d’un bandeau en saillie nommé larmier ou randière ceinturant l'édifice afin d’interdire l'escalade des nuisibles ?
Le pigeonnier-tour à toiture conique en poivrière possède une couverture en belles tuiles plates qui aurait bien besoin de rénovation mais les dépenses afférentes à la rénovation doivent être telles qu'elles sont probablement dissuasives sans aide d'institutions de protection du patrimoine…

Le clos de mur est enfin marqué, à son angle sud-ouest, par une tourelle d'angle, reconstitution récente d'une tour identique plus ancienne ayant sans doute fait partie du système de défense de l'ancien fief de la Loubantière.
✏︎ Autres témoins de l'habitat ancien
* Lorsqu'il ne suffisait pas d'ouvrir un robinet pour obtenir un précieux liquide…
Si l'adduction d'eau à Poitiers fut réalisée à partir de 1840 il fallut attendre 1936 pour Buxerolles.
En l'absence de fontaines, de cours d'eau ou de mares les puits ont longtemps été les seuls points d'approvisionnement en eau indispensable à la vie humaine mais aussi à l'élevage et à l'activité économique. Pour une commune comme Buxerolles, dont la majorité du territoire est formée par un vaste plateau à défaut de puits dont l'utilisation suppose une alimentation régulière en ce précieux liquide les ressources en eau devaient être fournies par des citernes où étaient recueillies l'eau de pluie.

Puits à l'Orbras.La margelle est constituée d'un bloc monolithique de pierre calcaire reposant sur le sol.

Puits à l'Ormeau profond de 44 mètres. On observe la présence des deux manivelles pour actionner le tambour.
Quand il n'y a pas de nappe phréatique, que les cours d'eau sont éloignés de la ville, du château ou de l'abbaye ou quand un puits se révèle insuffisant, que faire ? Utiliser des citernes.`
Celles-ci existent depuis l'Antiquité dans les régions sèches mais aussi dans les villes susceptibles d'être menacées de sièges. Ce sont des cavernes naturelles ou, surtout, des constructions humaines.
Une citerne est un réservoir souterrain qui sert à recueillir et à conserver les eaux pluviales. Elle doit être formée de murs solides, épais, imperméables, faits de matériaux insolubles dans l'eau et maçonnés avec des ciments hydrauliques.
Cet aménagement, doit permettre une utilisation régulière, quotidienne (bien souvent domestique à l'origine), ou une exploitation plus exceptionnelle en cas de sécheresse.

Une belle citerne de plus d'un siècle toujours en état de fonctionnement.
La surface effective du toit et les précipitations locales annuelles déterminent le volume d’eau de pluie qui peut être piégé.
Gros plan sur la partie aérienne joliment hexagonale de la citerne. On observe les canalisations qui l'alimentent et le système de puisage.
La collecte de l'eau de pluie par les toitures est ici bien évidente. La margelle est taillée dans un monolithe de pierre calcaire ; elle est usée par le frottement des seaux.
* Quand il fallait cuire son pain.
Historiquement le pain est traditionnellement une composante essentielle de l'alimentation : on consomme avant tout des produits à base de céréales comme des bouillies, des galettes ou du pain.
Après la Révolution le four communal appartenant à un groupe de voisins prit la place du" four banal". Aux alentours de 1900 on utilisait encore à la campagne des fours chauffés au bois pour cuire le pain de la semaine.
Si beaucoup de fours à pain dans les maisons de pays ont été détruits, il en subsiste toutefois quelques-uns sauvegardés et entretenus dans ces hameaux.

Vieux four à pain remis en état de marche dans son local. L'Ormeau
Four en excellent état de fonctionnement situé à l'Ormeau. 
Pelles à enfourner, racloir, balance sont encore observables dans la "boulangerie " de la maison.
* Ici et là de vénérables pierres ont résisté à l'épreuve du temps.

Cette lucarne-porte avec linteau monolithe et jambages en pierres reposant sur le mur de façade, observée sur une grange du logis de la Loubantière, est sans doute la plus ancienne lucarne de la commune.
Les lucarnes-portes découlent directement de la fonction agricole des combles ; certaines dénominations sont explicites : meunières, gerbières voire feunières car permettent d’engranger le foin.

Les vestiges d'un portail en plein cintre du XVIIe siècle témoignent d'une ancienne métairie à l'Ormeau.

Unique survivance d'un pilier engagé dans un mur surplombé par un chapeau mouluré avec boule. Peut-être le plus ancien des couronnements de piliers de la commune ?

Porte piétonne murée de 1761 témoignant d'une ancienne métairie à l’Ormeau.

Dans une ancienne cour de ferme on peut trouver un beau pilier, qu'on ne s'attend pas à découvrir, soutenant un grenier où l'on accédait par cet escalier contigu. Il s'agit sans doute d'un remploi.
_____________________
* Inventaire du patrimoine la région Poitou-Charentes 2008-2013
Yves Suire Buxerolles Maisons et fermes
https://gertrude-diffusion.poitou-charentes.fr/recherche/globale?texte=buxerolles&render=liste&type=Illustrations&start=0
* https://gertrude-diffusion.poitou-charentes.fr/recherche/globale?texte=buxerolles&render=liste&type=Illustrations&start=0
** COIRAULT Jean-Claude, DUPONT André, SAPIN André, SAPIN Michel - Buxerolles 1914-1918 Un village périurbain au rythme de la Grande Guerre, Gazette des Buis Hors Série n°2, 2016.