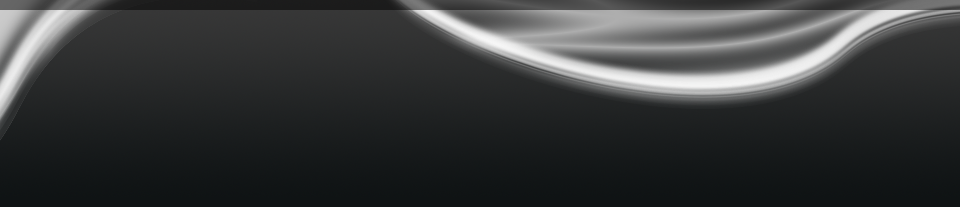.jpg)
L'éclatement de l'habitat de la commune en hameaux ne s'est-il pas fait au détriment du Bourg proprement dit ?
La taille réduite du " vieux bourg " peut s'expliquer, d'après l'Inventaire du patrimoine de la région Poitou-Charentes, de deux manières : d'abord, par un espace géographique communal ouvert où peu de contraintes pèsent sur l'implantation et l'expansion de l'habitat ; ensuite, par l'exploitation du sol par les notables et les abbayes de Poitiers sous l'Ancien Régime, qui s'appuyait sur des métairies autour desquelles se sont constitués les hameaux.
Du point de vue patrimonial trois éléments à titre principal peuvent être retenus : l'église, la mairie-école et quelques réalisations visibles ou non de la rue.
✏︎ L'église du " bourg " Saint-Philippe et Saint Jacques
Sur l'emplacement actuel de l'église du Bourg, placée sous le double patronage de Saint Jacques et de Saint Philippe, plusieurs constructions se sont succédé entre la période médiévale et le XIXe siècle.

L'église actuelle a été construite en 1868 sur l'emplacement d'un petit édifice roman du XIe siècle. C’était une modeste construction de 22 mètres sur 8, couverte d’une charpente apparente.
Cette première église avait été agrandie au 12e siècle, sa voûte avait été refaite au 15e siècle, la nef allongée au 17e siècle, et on lui avait adjoint en 1851 un clocher-proche.
De style néo-roman, l'église présente un plan en croix latine avec un clocher-porche, une nef unique à trois travées, un transept à deux travées et un chœur à une travée avec un chevet droit.
La place aujourd'hui située devant l'église du bourg, à l'Ouest, occupe l'emplacement de l'ancien cimetière qui se situait là jusqu'en 1873.

La « pierre des morts »; située sur le parvis de l’église cette dalle plate repose sur deux sobres pierres rectangulaires.
L’origine de cette appellation tient au fait que les porteurs y posaient les cercueils des défunts, avant d’entrer dans l’église.

L'église romane n’était entourée que par un jardin et la rue au Nord, l'ancien cimetière et une ferme, probablement l'ancienne métairie seigneuriale, à l'Ouest, le presbytère et son enclos au Sud.

Crédit photo : Yannis Suire
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers
Au Sud de l'église se trouvait l'ancien presbytère vers 1988. Selon le cadastre de 1817 et les descriptions d'archives, le presbytère était construit parallèlement à l'église dont il était séparé par une cour.
En 1990 le presbytère, vétuste, a été démoli.

La cour primitive du presbytère est aujourd'hui un jardin dans lequel on observe encore, à droite, près de l'église, l'ancienne citerne surmontée d'un mécanisme de puits.
La cour ouvrait à l'Ouest par un portail couvert à porte charretière et porte piétonne. Au Sud s'étendait le jardin clos de murs.
Il ne reste de cet ensemble qu'une partie du mur de clôture, joignant l'angle Sud-Ouest de l'église. Ce mur comprend encore la porte piétonne et présente un départ de portail avec un chasse-roue à sa base.

Dans le mur fermant le jardin à l'ouest, entre la porte piétonne et le départ de portail, a été incorporée une copie des armoiries de la famille de Lépinay-Richeteau, seigneurs de Buxerolles au XVIIe siècle :" d'or à un mûrier de sinople chargé de mûres, élevé sur une terrasse de même, au chef d'azur, chargé de trois étoiles dor." ( A. Dupont, Gazette, 2015 )

Citerne du jardin dit de l'abbé Colin .
La margelle du puits est constituée de deux blocs de pierre de forme trapézoïdale, dont les bords sont taillés en biseau, posés l'un au-dessus de l'autre, le bloc inférieur étant retourné.
Les côtés longs de chaque bloc sont moulurés. Le mécanisme est supporté par une armature métallique, et abrité par un toit en bois à longs pans.
Selon la tradition orale cette margelle serait constituée par un remploi des tables des deux autels latéraux de l'ancienne église détruite en 1868. Ces tables étaient, en effet, selon les descriptions de l'époque, taillées en biseau.

Dans le mur est de la sacristie est remployée horizontalement une pierre sculptée, peut-être à l'origine présentée verticalement. La base est moulurée et la partie haute comporte un écusson. Celui-ci semble représenter une feuille d'arbre inscrite dans un cercle, la queue enroulée, et portant des rayures verticales.

Toile du XVIIe siècle, provenant d'un retable, visible en la tribune et représentant les patrons de l'église.

Tabernacle du XVIIIe siècle, en bois peint et doré, provenant d'un monastère ; quatre têtes en médaillon finement sculptées et un calice surmonté d'une hostie.

Il reste de l'ancienne église quelques éléments sculptés dans le hall de l'Hôtel de Ville. Bénitier et chapiteaux à feuillages de l'église primitive en sont les vestiges les plus beaux.

A ce même hall du premier étage figure également une statue du XVe siècle de saint Jacques le Mineur patron avec saint-Philippe de l'église.
✏︎ Une ancienne mairie-école
Les vestiges d'un édifice, qui ouvrit ses portes en 1867, sont conservés et visibles dans l’architecture de la nouvelle école maternelle.
Jusqu'à cette date les enfants de Buxerolles étaient en effet obligés d'aller à Montamisé, au début du XIXe siècle, puis à l'école publique Saint-Germain à Poitiers ainsi que le rappellent André et Michel Sapin ( Gazette, n° 11, p. 48 )

L'ancien groupe mairie-école du bourg en mai 2020 transformé en école maternelle. .jpg)
L'école en 1972 ( collection A. et M. Sapin )
Une seule salle de classe, éclairée par une porte vitrée à arc en plein-cintre et par deux fenêtres.
Elle sera encadrée par deux pavillons. Le premier, à gauche, est destiné à la mairie. Le second pavillon, à droite, constituera le logement de l'instituteur.
Le petit clocher-arcade surplombe toujours la salle de classe d'origine.

Les originales têtes de piliers du portail ont été conservées lors d'une récente rénovation. Chapeau singulièrement ouvragé reposant sur une base type fortifications.
✏︎ Croix …et croix
C'est en mai 1920 que le conseil municipal décide d'ériger un monument aux morts, sur la place publique près de l'église, et sans "aucun signe ou emblème religieux".
Le monument en honneur des combattants disparus a été terminé en 1921 ou 1922 si l'on compte les travaux de l'entourage.

( Carte postale, collection Michel Sapin )
Le monument commémoratif de la Grande Guerre dans les années 1920 ; à sa droite une croix en bois, sans statue, du Christ.

Vue actuelle du site. A gauche, le monument honorant les combattants. Entouré par une grille métallique grise, il repose sur un socle à deux degrés. Il comprend deux niveaux : une base cubique sur laquelle est posé un obélisque tronqué.
A droite, la croix actuelle en bois, remplaçant celle en ciment armé érigée lors de la mission de février 1933, légèrement déplacée à la suite du récent réaménagement de la voirie.

L'obélisque est surmonté par une croix de guerre en pierre.
Sur le côté nord de la pyramide tronquée, est fixé un élément de décor en fonte représentant un casque de soldat entre un rameau d'olivier et un rameau de chêne, reliés par une croix de guerre pendante.
✏︎De modestes témoins silencieux du passé
Dans l'impossibilité de montrer directement les traces patrimoniales du café-épicerie du " Père Godu " une carte postale ancienne nous permettra de rappeler son importance au temps jadis et nous évoquerons seulement deux petits éléments du patrimoine dissimulés à la vue des passants.

Café-épicerie du " Père Godu " d'après une ancienne carte postale ( Collection Michel Portère )
Noces et banquets s'y tenaient et les hommes, lors des cérémonies de sépultures, pendant que les femmes assistaient aux offices, y prenaient un verre en attendant la sortie du cercueil de l'église …

Un puits est caché au fond d'une servitude d'une maison située en face de la place de l'église.
Le mécanisme est toujours en état de fonctionnement et en plus il y a de l'eau !
Une pierre gravée a été découverte sur un mur d'un cellier d'une maison proche de l'église et de l'ancienne mairie-école.
________________________